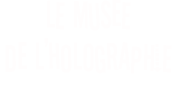Le cinéma holographique, fantasmes et réalité
Au début des années 80, on parlait beaucoup d’un film russe réalisé en Russie par le Pr Victor Komar en 77 au NIKFI. Mais quand j’ai visité ce laboratoire en 1981, on m’a montré un film 3D stéréoscopique mais d’holographique, point. Il semblerait que ce film 70 mm ait été réalisé à 8Hz avec 8 lasers à rubis.
La présentation sur écran était possible pour 4 spectateurs.
Au LOBE, Laboratoire d’Optique de Besançon, Nicole Aebischer travaillait sur les hologrammes animés ANVAR n° 15521, 1978. Les portraits animés enregistraient sur la même plaque dix expressions différentes d’un même sujet.

Figure 1 : Nicole Aebischer devant son portrait animé
En se déplaçant devant la plaque, le visiteur voyait le portrait s’animer.Une réalisation de ce type a été entreprise au LOBE, en collaboration avec des chercheurs du LEAC Laboratoire d’Expérimentation en Arts Cinégraphiques, Pari VIII, Claudine Eizykman et Guy Fihman, ayant pour thème un vol de goélands a été présentée en novembre 81 au LOBE, puis en avril 82 au Collège de France, à Paris, exclusivement par le LEAC. Une plaque 50X60 cm montrant les oiseaux de Marey en vol éclairés par un puissant laser argon.
Cette présentation au Collège de France, par le LEAC a eu un retentissement médiatique tel que le LOBE s’est considéré comme spolié et a cessé toutes ses recherches dans l’imagerie holographique. Le LEAC s’est tourné vers un autre partenaire, l’ ISL , Institut Franco-Allemand de Saint Louis. Son directeur, le Pr Paul Smigielski, faisait de petits films pour des études de balistique.

Les films présentés par le LEAC au Collège de France et au Centre Pompidou dans l’exposition « Les immatériaux » en décembre 83 et février 84 ont tous été réalisés à l’ISL


Figures 3 et 4 : Prise de vue et visualisation © ISL

Figure 5 : Alexander et Danielle au laboratoire du Musée
En 1985, Alexander était artiste en résidence au laboratoire du Musée de l’Holographie.
Le Musée de L’holographie et l’ISL ont coproduit le film de fiction « La belle et la bête » d’’Alexander, inspiré par Jean Cocteau (1945) avec Danielle dans le rôle de la Belle et Alexander dans le rôle de la bête sonorisé par Alexander.126mm, soit une fenêtre pour les deux yeux alors que dans les premiers films, de 35mm c’était un seul œil, 80 secondes de durée et un éclairage laser. Les limitations de la technique étaient décevantes.
Le film montrait davantage les limites du procédé en tant que forme artistique que son potentiel.
Alexander
Proceedings Volume 2333, Fifth International Symposium on Display Holography; (1995) https://doi.org/10.1117/12.201899
Event: Display Holography: Fifth International Symposium, 1994, Lake Forest, IL, United States
Abstract © SPIE
In 1985 Anne-Marie Christakis selected me to make the first pulse holographic feature-fiction movie. Up that time, the process had only been used for laboratory tests. The running time for the movie was to be 1 minute 20 seconds. Apparently quite long compared with previous tests, but an extremely short time in which to tell a story. I chose the characters of Beauty and the Beast. A lot of time was spent in preparatory work: triple distilling the scenario to get it down to 80 seconds; paintings and masks, and I extracted the music from a suite I had already written in medieval style. The movie was made in 1986 in the laboratory of Professeur Smigielsky, which was located in the Franco-German Defense Research Establishment, at St. Louis in France. Prof. Smigielsky’s staff operated all the equipment and Anne-Marie Christakis coordinated everything, as she had done throughout the project. As soon as we arrived at the laboratory, we were told not to look beyond a certain angle towards the laser, otherwise we could be blinded for life. With all that dangerous power however, it was only possible to illuminate a volume for the set of half a meter wide by half a meter deep by one third of a meter high. Such a set gives real meaning to the expression `cramp one’s style.’ The layout used was, in principle, the same as for making a simple hologram. A pulsed YAG laser was used and each pulse was synchronized with a new frame to be exposed in the camera. When the movie was finished, it was not very bright, and one had to look through a small aperture to view it
Au lieu de rejeter complètement l’idée de l’holocinéma, Alexander s’est inspiré de sa première expérience avec des scientifiques de l’ISL et a entrepris de développer une nouvelle stratégie de réalisation de films holographiques expérimentaux, basée sur une technique plus simple, le film holographique « Masks » selon la méthode de Llyod Cross, filmé par Sharon Mac Cormack. Visible en lumière blanche, pour une dizaine de personnes, avec une fenêtre de 18×23 cm, le film durait 8 mn. Le rouleau de film avançait de droite à gauche par un support motorisé.

Figure 7: le film “Masks”.
Nous avons présenté les deux films, en même temps au Musée de l’Holographie, en juin 87.
Ce qu’il adviendra du cinéma holographique est difficile à dire. Les prédictions sur l’avenir du cinéma holographique ont échoué lamentablement. Truffaut disait « le cinéma, ce n’est que 24 images secondes », certes, mais le manque de projection est un écueil.
Les recherches sur les écrans holographiques ont été abandonnées en Russie il y a près de trente ans et il est probable que les quelques films holographiques expérimentaux demeureront une curiosité de laboratoire sans lendemain. Mais si les avancées technologiques continuent, le cinéma holographique pourrait devenir une révolution dans les décennies à venir.